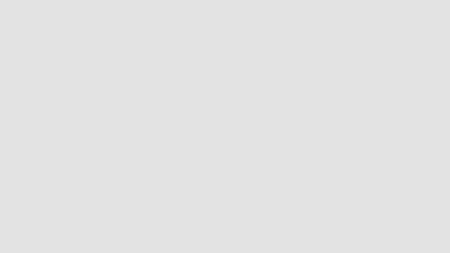L'Histoire française est longue et surtout truffée d'anecdotes insolites, notamment sur sa royauté. Entre les morts ridicules, fistules royales et manies énervantes à table, nous vous présentons quelques souvenirs cocasses de rois de France, qui demeurent désormais gravés dans les annales.
Envie de savoir comment l'hymne britannique trouve son origine dans l'opération du royal derrière de Louis XIV ? Cliquez sur la suite !