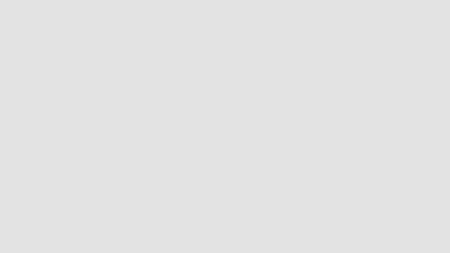C'est l'un des conflits militaires les moins connus et les moins discutés de l'histoire des États-Unis. Pourtant, la guerre américano-mexicaine (1846-1848) a joué un rôle crucial dans la modification des frontières et du caractère de la nation. L'effet sur le Mexique a été désastreux et l'impact négatif sur le pays a été à la fois immédiat et durable. Cette confrontation brève mais brutale a également renforcé les pires stéréotypes que chaque pays entretenait à l'égard de l'autre. Qu'est-ce qui a poussé ces deux voisins à prendre les armes l'un contre l'autre et quelle en a été l'issue ?
Cliquez sur cette galerie et revivez le premier conflit armé américain mené principalement sur un sol étranger.